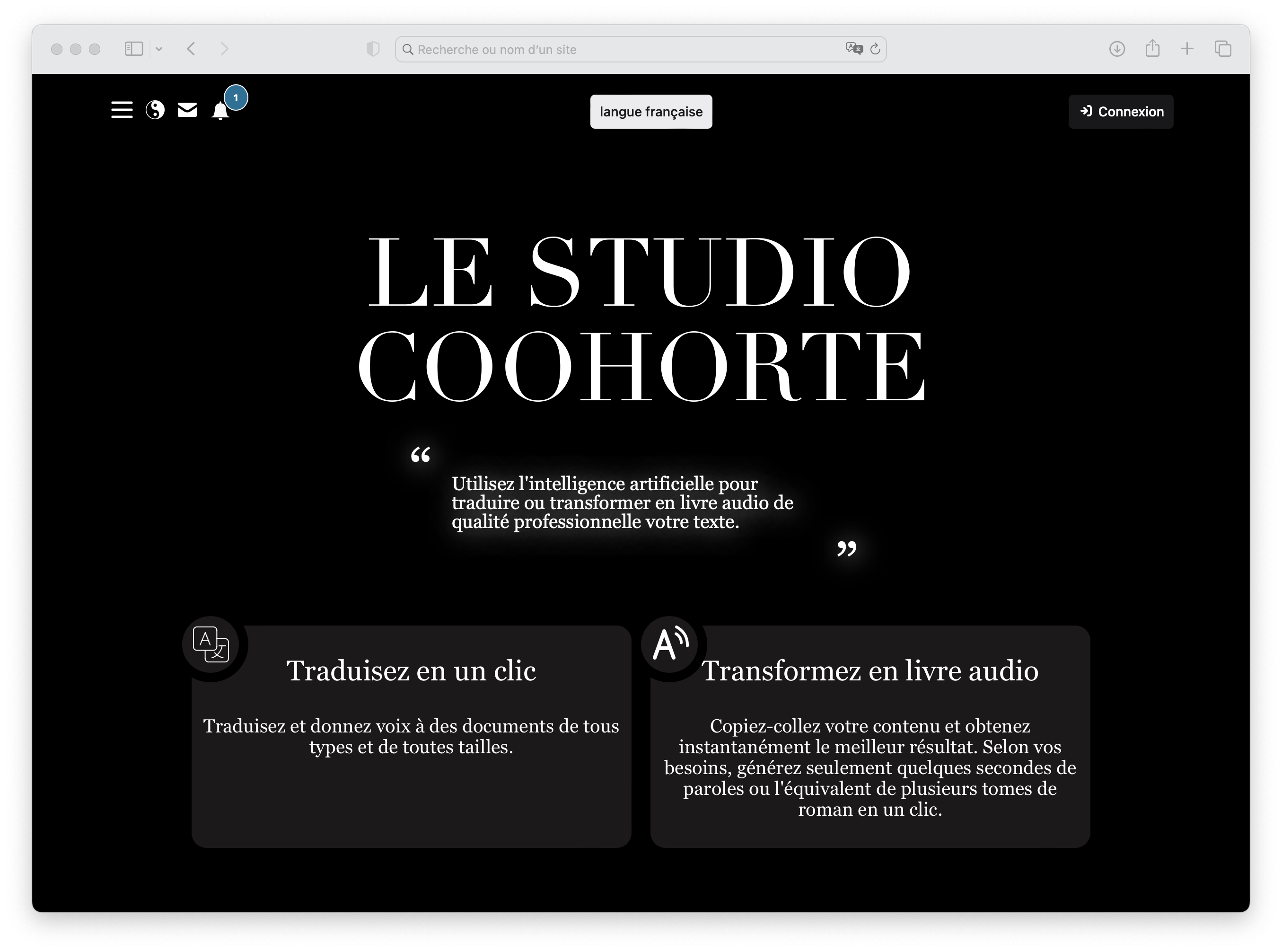Cowboy
J’arrive sur la place centrale du village. Autour de mes hanches, je sens l’étreinte lâche et faussement rassurante du ceinturon qui porte mon colt [..]
Récit court
Seth Messenger
C’est une belle journée d’été.
Le soleil est déjà haut dans ce ciel de grand Ouest américain. Les rares nantis ayant les moyens de posséder une montre pourraient y lire qu’il est bientôt onze heures. Une heure habituellement animée sur la rue centrale de ce petit village de colons construit par des mains valeureuses il y a à peine dix ans. Habituellement, mais pas ce matin. La rue est déserte. Les volets sont clos. La canicule déjà prononcée sèche cette atmosphère parfaitement silencieuse qui a comme réquisitionné ce lieu. L’air, mêlé de poussière, est si sec que même une activité physique modérée demande un effort à mes poumons.
Accompagnés du tintement timide de mes éperons, mes pas me mènent précautionneusement le long de la large rue. Des odeurs d’urines et fientes emplissent l’air matinal, autant animales qu’humaines. Le tout-à-l’égout n’a pas encore été inventé ici et les hommes s’affairent de leurs besoins naturels dans les ruelles fuyant vers la périphérie de la rue centrale. Les chevaux n’ont pas cette délicatesse. Leurs déjections copieuses tapissent la rue, conséquemment envahie en permanence par une armée d’insectes nécrophages.
Je dépasse le saloon où j’entraperçois quelques silhouettes noyées dans l’obscurité. Les lampes à huile, indispensables pour éclairer cet antre d’humanité, n’ont pas encore été allumées, signifiant l’activité réduite du débit de boisson. Les choses précieuses comme les bonnes bouteilles ont été placées sous l’épais établi du bar. A l’abri d’une éventuelle balle perdue. C’est qu’en ces terres reculées, un bon alcool est plus important aux yeux de beaucoup que la vie d’un homme. Pour les mêmes raisons, les filles de l’établissement sont restées à l’abri dans leurs chambres, à l’étage. En ces lieux, elles constituent une source d’enivrement encore plus précieuse qu’un bon alcool. Leur absence contribue à vider de vie le lieu autant que l’évènement qui s’annonce.
Tapi dans l’ombre, un regard gris acéré flotte au-dessus d’un verre à moitié vide. Je peux y lire un message évident. Il ne veut pas rater le spectacle.
Un peu plus loin, j’atteins les abreuvoirs où une eau douteuse, saumâtre, sert habituellement de rafraîchissement aux chevaux. Cependant, aucun équidé n’en fait usage ce matin. Comme les filles du saloon et les bons alcools, les montures ont été mises à l’abri dans les ruelles. Et pour les mêmes raisons.
Plus généralement, derrière les épaisses planches en bois qui font office de volets clos, des bruits menus se font parfois entendre. Probablement accidentels, peut-être issus de la maladresse des quelques rares enfants en bas âge qui vivent derrière les murs. Sans doute oui, car à cet instant, personne ne veut attirer l’attention vers sa demeure.
Loin des clichés qui seront véhiculés une centaine d’années plus tard dans les films de western, cette époque n’est pas faite uniquement par des ivrognes ou des brutes à la gâchette facile. Une majorité de colons essaient ici de construire une vie, un avenir. C’est une vie dure où la sécheresse peut mener à la famine ou la mort, les conditions sanitaires décimer une ville en quelques semaines par suite d’infections ou d’une épidémie. Une vie ou la violence est omniprésente, en embuscade à chaque seconde, comme dans toute civilisation naissante. Ici, il n’y a pas de police pour faire régner l’ordre et les seuls droits que vous puissiez faire valoir sont ceux que vous êtes à même de pouvoir défendre, seul ou avec vos alliés. L’ordre ne tient qu’à un fil. Et ce fil n’a finalement que l’épaisseur du respect ou de la crainte que vous inspirez à ceux que vous croisez.
C’est la raison qui guide mes pas en cette fin de matinée.
J’arrive sur la place centrale du village.
Autour de mes hanches, je sens l’étreinte lâche et faussement rassurante du ceinturon qui porte mon colt. Sur la gauche, une petite église faite de planches grossièrement taillées, comme toutes les autres bâtisses de la ville. A son sommet, une pendule mécanique qu’une âme pieuse et charitable remonte deux fois par jour pour que les passants qui s’intéressent au fil du temps puissent connaître l’heure exacte attribuée à un instant de leur vie. Les aiguilles indiquent onze heures.
En face de moi, l’homme est au rendez-vous.
En cette heure dite.
La hargne huilée par l’alcool de la veille a quitté son regard, à présent sobre et limpide. Nous avons tous deux lentement dégagé nos vestons, la main prête à saisir nos armes respectives. Dans son regard, je peux lire aussi sûrement qu’en moi-même qu’il regrette cette querelle idiote et ses conséquences. Ce n’est pas une brute, juste un homme seul qui avait trop bu et qui s’est laissé emporter par sa fierté. Mais les regrets ne font pas le poids en cette époque ou votre honneur est votre seule richesse, le pilier de votre survie. Il n’y aura pas de retour arrière. Chacun de nous le sait. Et l’une de nos précieuses vies devra bientôt céder le pas à l’autre.
Je plonge mon regard dans le sien.
Il y a du respect entre nous à présent, de la peur. Mais aussi du courage. Nous sommes prêts à brader notre bien le plus précieux, notre vie, au nom d’un concept abstrait. C’est ce qui fait de nous des humains. Cette capacité à ériger une folie conceptuelle en réalité tangible incontournable et inévitable. Aucun autre animal sur terre n’irait jusqu’à tuer pour un regard de travers échangé quelques secondes durant.
Je suis plus qu’un mauvais tireur. Et l’homme en face de moi a la réputation de viser juste à la chasse.
Mais cela n’a pas vraiment d’importance. J’ai fait, fait et ferai mon chemin dans cette vie comme dans tant d’autres au fil du temps. Malgré tout, j’aime cette époque. Dure et violente, c’est aussi une époque de liberté, d’autonomie. Elle permet de choisir d’être soi, quitte à en mourir. A l’avenir, dans d’autres vies, d’autres époques plus civilisées et aseptisées, il n’y aura plus d’insécurité, plus de violence. Mais aussi plus de liberté. Cette formidable illusion. Oui cette époque est unique, comme toutes les autres. Et précieuse. Comme toutes les autres.
Dans les quelques dernières secondes de cette vie, j’analyse l’air vicié que mes poumons peuvent encore respirer difficilement. Dans ma mémoire, je le compare à cet air artificiellement purifié que je respirerai un jour, dans une autre vie que je n’ai pas encore vécue, à quelques siècles de là, dans la pièce climatisée d’un vaisseau spatial me menant sur une autre planète. J’éprouve aussi la nostalgie de cette autre vie, il y a plusieurs millions d’années, où mes pattes me guidaient dans une végétation luxuriante et flamboyante, à l’ombre de créatures titanesques. Dans chaque seconde, je vois et revis l’infinité des vies qui ont été, sont et seront les miennes depuis l’aube de l’univers et jusqu’à son effondrement.
La balle a quitté le revolver de mon adversaire.
Je n’ai pas même eu le temps de pointer le canon du mien vers lui. C’est mieux ainsi. Je n’ai jamais pris plaisir à ôter la vie. Dans cette dernière seconde qui scellera le sort et le dernier chapitre de cette existence, je suis serein, car je sais que le temps est une illusion. Qu’il est possible de se souvenir du futur comme du passé, mais pas de changer le présent. L’histoire de l’univers est déjà écrite et ne se terminera jamais. Comment le pourrait-elle ? Puisqu’elle n’a jamais commencé...
Vous ne comprenez pas ? Peu importe. Sachez seulement ceci. Même si vous vivez dans l’illusion de l’écoulement du temps et de vos consciences, la vie les transcende. Et c’est là que j’existe. A l’abri du temps et de l’espace.
Comme un passager embarqué.
Ivre d’un spectacle infini.
Seth Messenger, terminé à Poissy le dix octobre deux-mil vingt à midi.